
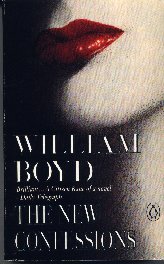

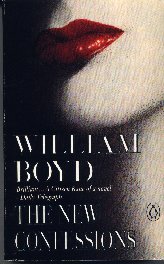
Les Nouvelles Confessions mettent en scène un cinéaste britannique fictif nommé John James Todd. De sa naissance en Ecosse à la fin du XIXè siècle jusqu’à l’approche de sa mort au début des années 70, il nous livre un récit de sa vie dans lequel l’autobiographie de Rousseau joue le rôle de pôle structurant.. D’une part, la vie de John James Todd, telle qu’elle est racontée dans le roman, transpose à plusieurs reprises des épisodes rapportés dans Les Confessions. D’autre part, l’un des points essentiels de l’intrigue réside dans le fait que le héros du roman a entrepris plusieurs fois le tournage d’une adaptation cinématographique des Confessions. Mais les aléas de l’histoire et de la vie privée l’ont toujours empêché de donner au film la forme dont il rêvait. Le roman démarque ironiquement de nombreux passages des Confessions, notamment le célèbre préambule :
Voici l’histoire d’une vie. Ma vie. La vie d’un homme au vingtième siècle. Ce que j’ai fait et ce qu’on m’a fait. Si parfois il m’est arrivé d’employer quelque ornement innocent, cela n’a jamais été que pour pallier un défaut de mémoire. J’ai pu quelquefois prendre pour un fait ce qui n’était guère plus qu’une probabilité, mais – et ceci est capital – je n’ai jamais fait passer pour vrai ce que je savais être faux. Je me montre tel que je fus : méprisable et vil quand je me comportai de la sorte ; bon, généreux et sublime quand je l’ai été. J’ai toujours observé de très près ceux qui m’entouraient et je ne me suis pas épargné ce même examen minutieux. Je suis tout simplement un réaliste. Je ne juge pas. Je note. Ainsi donc, me voici. Vous pourrez gémir sur mes incroyables gaffes, me maudire pour mes innombrables imbécillités et rougir jusqu’à la racine des cheveux de mes confessions, mais – mais – pouvez-vous, je me le demande, pouvez-vous vraiment mettre la main sur votre coeur et dire : " Je fus meilleur que lui ? " (p. 13)
Mon premier acte en entrant dans ce monde fut de tuer ma mère. On me sortit de son ventre – huit livres robustes laquées rouge vif – un jour froid de mars 1899 à Edimbourg. [...] La date de ma naissance est celle de sa mort et c’est ainsi que commencèrent mes malheurs. (p. 11)
Vous comprendrez que l’adolescent moyen de dix-sept ans maîtrise peu ou mal ses affections. Dans mon cas, il s’agissait d’une incapacité singulière. Je vis sous l’emprise de mes émotions. Même en tant qu’adulte, leur résister est un combat épuisant. Je ne possédais, à l’époque, aucune souplesse de caractère. Cette sorte de nature est à la fois un bonheur et une malédiction. Essayez de me comprendre tel que j’étais et ne me jugez pas trop durement quand vous apprendrez ce qui arriva ensuite. (p 79)
Personnellement, je n’ai jamais perdu cette capacité juvénile de sentir à l’état brut. Dieu merci. C’est ce qui me situe à l’écart de la majorité des gens, paralysés par la bienséance et les conventions, étouffés par les notions de respect et de statut. Aujourd’hui encore, je peux revivre la jalousie de mes dix-sept ans, la sentir m’étreindre la gorge, me labourer les entrailles. (p. 81)
Je rapporte les événements suivants tels que je me les rappelle. Je ne cherche nullement à m’excuser, ni moi ni ma conduite bizarre. J’avais dix-sept ans. Ne l’oubliez pas, s’il vous plait. (p. 85)
Je continuai ma traversée de la ville en mangeant mon pâté. Mon pardessus me tenait trop chaud. Je l’ôtai. Le ciel était laiteux, le soleil invisible, la poussière sur les bas-côtés de la route blanche. Mes grosses chaussures faisaient crisser le gravier de la route non pavée. Un instant, deux petits galopins aux pieds nus me coururent derrière, se moquant de mon kilt et me criant des horreurs dans leur impossible dialecte. Je les menaçai de deux cailloux et ils détalèrent. (p. 86)
Le roman que je m’étais laissé allé aller à bâtir et chérir avec tant d’imagination s’était révélé n’être que cela et les dures vérités sur lesquelles je devais me rabattre n’étaient guère réconfortantes. (p. 107)
Le livre me fut remis en pages détachées, dans la cour de promenade. [...] Je n’oublierai jamais mon excitation, ce premier jour où j’extirpai le paquet de feuilles coincé entre les planches. De retour dans ma cellule, je fourrai le tout sous mon matelas, sauf la première page [...]
J’étais prêt à commencer. [...] Karl-Heinz ne m’avait donné que le texte – j’ignorais le titre, j’ignorais l’auteur. Je ne savais rien du sujet du livre ni de son genre. Pourtant, assis là dans cette cellule, j’eus l’impression d’être à l’orée d’une merveilleuse aventure et de tenir entre mes mains fiévreuses quelque chose d’immensément précieux. Ce fut un instant divin. Il allait changer ma vie.
"Chapitre Un. "
Mon
coeur battait follement d’impatience. La première
phrase, le premier paragraphe...à quoi ressembleraient-ils ?
Je lus :
" Je forme une entreprise qui
n’eut jamais d’exemple et dont l’exécution
[...] n’être fait comme aucun de ceux qui existent " Mon émotion
fut telle qu’il me fallut reposer la page. Mon coeur se démenait
dans ma poitrine, y battant à grands coups. [...] Mais
jamais je n’ai lu un tel prologue à un livre, jamais
je n’ai été aussi puissamment et immédiatement
emporté. Qui était cet homme ? A qui appartenait
cette voix qui m’interpellait si directement, dont l’impudeur
effrontée retentissait de tant d’honnêteté
sincère ? Hypnotisé, je poursuivis ma lecture.
(p. 225)
J’allais faire le plus grand film que le monde ait jamais vu. Il serait sans exemple et n’aurait pas d’imitateur. J’allais faire un film des Confessions de Jean-Jacques Rousseau. (p. 303)
Ceci démontre désagréablement à quel point les Confessions : Première Partie m’absorbaient. Ma vie de famille n’était guère plus qu’une toile de fond. Elle ne retenait mon attention que lorsque je m’y appliquais. J’en restai abasourdi. Tout d’un coup, j’avais quatre enfants ! J’éprouvais de vagues accès de panique. Que diable étais-je en train de faire ? (p. 318)
Nous partîmes pour Annecy en septembre, une immense caravane d’acteurs, de techniciens et d’équipement occupant un train entier. J’étais fou de joie de voir cette troupe rassemblée sous mes ordres, mais je me sentais inquiet aussi. Quand Rousseau s’en va voir Mme de Warens pour la première fois, il envisage la rencontre comme une " terrible audience ". A présent, j’éprouvais un peu ce genre d’appréhension. (p. 345)
Elle me flanqua une bonne
raclée. Mes fesses rougirent puis brûlèrent.
L’érection que j’avais eue s’affaissa totalement.
- Plus
fort ?
- Non. Arrête, dis-je faiblement. Je me relevai.
" Ouille ! fis-je en frottant mon derrière
douloureux. Quel foutu supplice ! (p. 385)
Par une très
belle journée, il alla se promener à la campagne.
Dans un vallon, le long d’un ruisseau, il rencontra deux
jeunes filles qui avaient des difficultés à faire
traverser leurs chevaux. Rousseau connaissait déjà
l’une d’elles – une Mlle de Graffenried –,
qui le présenta à son amie – Mlle Galley. Elles
étaient toutes deux jolies, surtout Mlle Galley qui était
" en même temps très mignonne et très
formée, ce qui est pour une fille le plus beau moment ".
Rousseau les aida à franchir le gué, et les jeunes
filles insistèrent pour qu’il les accompagne le reste
de la journée. Elles se rendaient au château de la
Tour, à Thônes, une grande ferme appartenant à
la famille de Mlle Galley.
Une fois arrivés
au château, ils firent un charmant déjeuner dans
la cuisine. Gardant pour plus tard leur café et leurs gâteaux,
ils décidèrent d’achever leur repas en allant
cueillir des cerises dans le verger du château. Rousseau
grimpa aux arbres et jeta des cerises aux filles qui lui renvoyèrent
les noyaux pour s’amuser. Un jeu galant s’ensuivit.
[...] Mais rien ne se passa. Ce fut une idylle vibrante de sous-entendus
sensuels et de virtualités inaccomplies. Comme vous pouvez
l’imaginer, cette scène s’était gravée
au fer chaud dans mon esprit lorsque je l’avais lue dans
ma froide cellule de Weilberg. (p. 371)